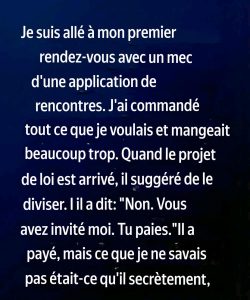Ou plus précisément, la mère de la femme qui avait été mon univers tout entier… et ma blessure la plus profonde.
Cinq ans, trois mois et deux jours s’étaient écoulés depuis la disparition de Marina. Je n’ai jamais aimé parler de sa « mort », même si la logique me disait le contraire. Pour moi, elle n’était pas morte. Elle s’était volatilisée, laissant derrière elle un côté du lit vide et un silence si pesant qu’il résonnait dans chaque pièce de cette maison que nous avions bâtie avec tant d’espoir.
Ils ont dit que c’était un accident de voiture. Marina se rendait chez sa famille, dans un village côtier à six heures de route. Le rapport de police était bref. Le cercueil est arrivé scellé, soi-disant parce que le choc avait été trop violent. Les funérailles se sont déroulées comme dans un brouillard : les visages étaient voilés par le chagrin, des bras m’entouraient tandis que je ne ressentais absolument rien.
Le souvenir le plus clair que j’ai de cette journée, c’est celui de Doña Clara — petite, fragile, tremblante — agrippée à moi comme si j’étais la dernière chose qui la maintenait debout.
Au milieu de cette dévastation partagée, j’ai fait une promesse.
Marina s’était toujours inquiétée pour sa mère. Veuve. Une petite pension. Une santé déclinante.
« S’il m’arrive quoi que ce soit », avait-elle dit un jour à moitié en plaisantant, « s’il vous plaît, ne la laissez pas souffrir. »
Debout près de la tombe, la terre encore fraîche, j’ai juré à Doña Clara qu’elle ne le ferait jamais.
« Je prendrai soin de toi », lui dis-je, les mains tremblantes tandis que j’essuyais ses larmes. « Tous les mois. Pour la nourriture, pour les médicaments. C’est ce que Marina aurait voulu. »
Elle hocha la tête, reconnaissante et le cœur brisé, et retourna dans son village.
À partir de ce jour, chaque mois, l’argent était prélevé sur mon compte. Ce n’était pas une fortune, mais pour moi, c’était sacré : un rituel discret qui me permettait de garder un lien avec ma femme, même après sa disparition. Envoyer cet argent était pour moi la preuve que j’étais toujours un bon mari, que j’honorais sa mémoire.
Mes amis m’ont dit qu’il était temps d’arrêter.
« Roberto, ça fait des années », me disait mon meilleur ami Jorge autour d’une bière. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Cette femme n’est plus ta responsabilité. »
« Ce n’est pas à propos d’elle », répondais-je toujours. « C’est à propos de Marina. »
Je ne me rendais pas compte alors que le chagrin, lorsqu’il est laissé de côté trop longtemps, finit par laisser éclater la vérité qui le déchire.
Tout a basculé un mardi comme les autres.
La banque m’a contacté, non pas pour un relevé, mais pour un problème. L’agence locale de Doña Clara avait fermé et ils avaient besoin d’informations à jour pour continuer à traiter les virements. J’ai essayé de l’appeler sur son téléphone fixe. Coupure. J’ai essayé sur le portable que je lui avais offert. Directement sur sa messagerie.
Une étrange sensation s’installa dans ma poitrine – pas de panique, mais quelque chose de plus froid. Un avertissement silencieux.
Je me suis rendu compte que je ne lui avais pas vraiment parlé depuis des mois. Juste de courts messages de remerciement.
J’ai consulté mon calendrier. J’avais des jours de congé non utilisés. Mes clés de voiture étaient posées sur la table.
« Pourquoi pas ? » me suis-je dit. « J’irai la voir. Je réglerai le problème de la banque en personne. Je m’assurerai qu’elle va bien. Peut-être même visiter les endroits où Marina a grandi. Peut-être que cela m’aidera enfin à tourner la page. »
J’ignorais totalement que je me dirigeais vers une vérité qui allait anéantir toutes mes croyances.
La route était longue et déserte. Au fil des kilomètres, les souvenirs défilaient dans ma tête : le rire de Marina, sa façon d’incliner la tête en écoutant de la musique, le léger parfum de vanille dans ses cheveux. Je pleurais en silence, comme je ne le faisais jamais que lorsque j’étais seule.
J’arrivai au village au crépuscule. Il avait un charme d’antan, comme figé dans le temps : rues pavées, maisons colorées et une impression de délabrement sous cette beauté trompeuse. Je n’y étais pas retourné depuis les funérailles.
Je suis allé en voiture jusqu’à la Calle Las Flores, numéro 42.
Et il s’est arrêté.
La maison n’était pas comme dans mes souvenirs.
Les murs défraîchis avaient disparu, remplacés par une peinture jaune vif et fraîche. Le jardin était impeccable : roses, bougainvillées, haies taillées au cordeau. Une nouvelle clôture en bois encadrait la propriété. Et garée dans l’allée, une berline qui paraissait presque neuve.
J’ai revérifié l’adresse.
C’était exact.
« Peut-être qu’elle s’en est bien sortie », me suis-je dit. « Peut-être que 300 dollars par mois, c’est une somme importante ici. »
Pourtant, un malaise m’accompagnait lorsque je suis sortie de la voiture avec les cadeaux.
J’ai sonné à la porte.
Des rires s’échappaient de l’intérieur.
Rires d’enfants.
Et la voix d’une femme.
Une voix qui m’a glacé le sang.
Je me suis figée. Ce rire — léger, musical, se terminant par un doux soupir — je le reconnaîtrais entre mille.
« Ce n’est pas réel », me disais-je. « Tu es épuisée. Le chagrin fait ça. »
La porte s’ouvrit.
Un petit garçon, pas plus âgé que quatre ans, tenait un jouet en plastique. Il me regardait avec curiosité.
« Qui êtes-vous ? » demanda-t-il.
Avant que je puisse répondre, une voix a appelé de l’intérieur :
« Mateo, n’ouvre pas la porte comme ça ! »
Elle entra dans le couloir en s’essuyant les mains avec un torchon.
Le temps s’est arrêté.
la suite au page suivante